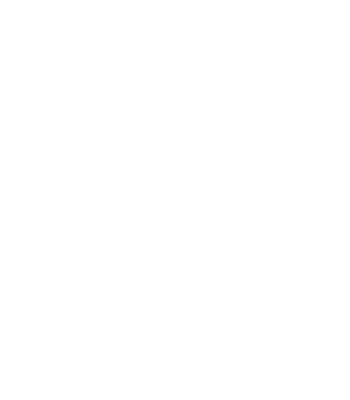Répression des atteintes aux espèces protégées : évolution du cadre juridique

La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a modifié le cadre répressif des atteintes aux espèces protégées (art. 31).
À la suite d’une saisine du Conseil constitutionnel, certaines dispositions de la loi, instaurant des présomptions de non-intentionnalité, ont été censurées (Cons. const, 20 mars 2025, no 2025–876 DC).
La loi no 2025-268 du 24 mars 2025 a finalement été publiée au JORF le 25 mars 2025 : les dispositions ayant passé le filtre constitutionnel sont donc entrées en vigueur le mercredi 26 mars 2025.
Voici un rapide tour d’horizon du nouveau cadre répressif applicable en cas d’atteinte aux espèces protégées.
1. Volet pénal
Pour mémoire, l’article L. 415–3 du code de l’environnement réprime le délit d’atteinte à la conservation d’espèces protégées (3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).
1.1. Au titre de l’élément matériel du délit
En pratique, sont concernées :
- Les atteintes occasionnées aux espèces alors qu’une dérogation était requise mais n’a pas été obtenue au préalable ;
- Les atteintes occasionnées aux espèces en méconnaissance de la dérogation obtenue ;
- La simple abstention de satisfaire aux prescriptions de la dérogation (Cass. Crim., 18 oct. 2022, no 21–86.965).
1.2. Au titre de l’élément moral du délit
Ces dernières années, la Cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, qu’une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit (Cass. crim., 18 oct. 2022, no 21–86.965 ; Cass. crim., 14 nov. 2023, no 22–86.922).
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article L. 415–3 du code de l’environnement prévoit que l’élément moral est uniquement caractérisé lorsque les faits sont « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave ».
Reste à savoir comment la chambre criminelle interprétera ces notions d’intention et de négligence grave, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, cette juridiction considère que « pour que la condition relative au caractère intentionnel figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive “habitats” soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort (arrêt du 18 mai 2006, Commission/Espagne, C‑221/04, EU:C:2006:329, point 71). La même constatation s’applique aux interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive » (CJUE, 4 mars 2021, aff. jointes C‑473/19 et C‑474/19).
1.3. Censure des présomptions de non-intentionnalité par le Conseil constitutionnel :
L’article 31, 3°, b). prévoyait de modifier l’article L. 415–3 du code de l’environnement afin d’instituer deux présomptions d’absence d’intention applicables au délit d’atteinte aux espèces protégées.
D’une part, il était prévu que les faits concernés soient réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle lorsqu’ils répondent à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative.
Ces dispositions ont été censurées pour méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (pt. 61 à 65).
D’autre part, une présomption de non-intentionnalité était instaurée pour « l’exercice des activités prévues par des documents de gestion [forestiers] (…) dans des conditions qui comprennent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ».
Ces dispositions ont également été censurées pour méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines (pt. 66 à 68).
2. Volet administratif
2.1. Rappel du cadre juridique
Pour mémoire, l’article L. 171–7 du code de l’environnement prévoit (notamment) que lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de la déclaration, etc. requis en application du code de l’environnement (ce qui inclut la dérogation au régime de protection des espèces prévue à l’article L. 411–2 du même code), alors :
- le préfet est tenu de mettre en demeure la personne intéressée de régulariser sa situation (compétence liée) ;
- le préfet peut imposer le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal de 45 000 euros.
2.2. Nouvelles dispositions pour les personnes physiques exclusivement
Désormais, le nouvel article L. 171–7‑2 du code de l’environnement prévoit qu’en cas d’atteinte aux espèces protégées sans avoir obtenu au préalable la dérogation requise, ou bien en cas d’atteinte aux espèces protégées en cas de non-respect de la dérogation obtenue, alors, le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 171–7 du même code ne peut pas excéder 450 € à la double condition que :
- cette atteinte est le fait d’une personne physique ;
- cette atteinte n’a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave.
Observation : ce texte nous semble mal rédigé, car l’article L. 171–7 vise exclusivement l’absence d’une autorisation requise en application du code de l’environnement, et non pas la méconnaissance de prescriptions prévues par une autorisation délivrée en application du code de l’environnement (c’est l’article L. 171–8).
Par ailleurs :
- Hors cas de récidive : la personne responsable de l’atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d’un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L’acquittement de l’amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.
- En cas de récidive dans un délai de cinq ans : le montant de l’amende est porté à 1 500 €.